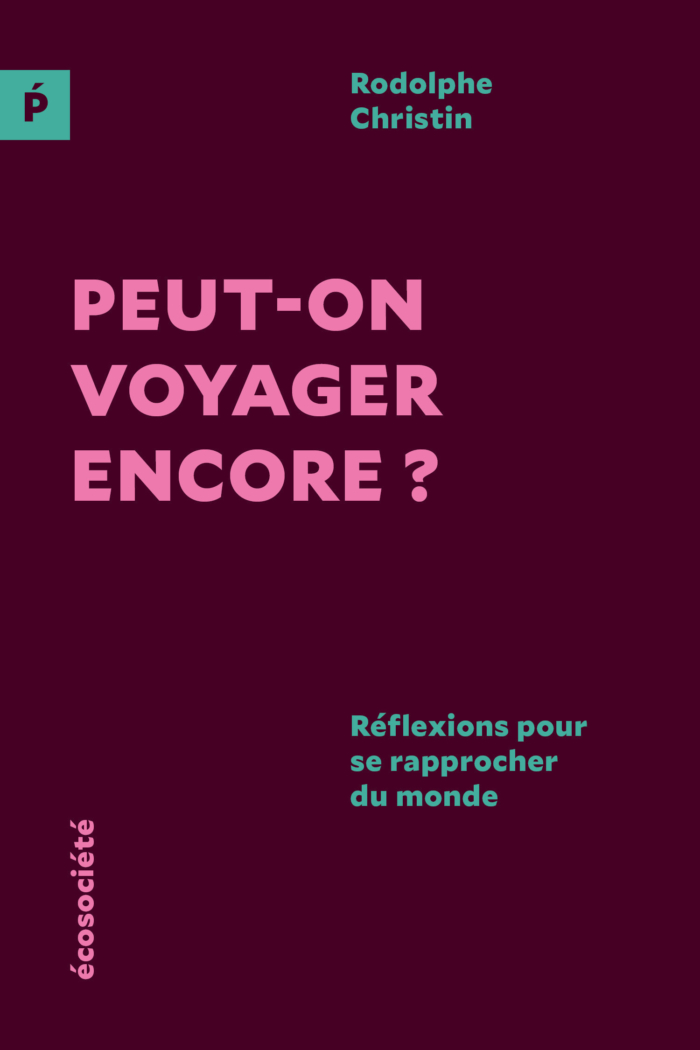Difficile d'être populaire!...
Elle a tout le monde sur le dos, ou presque, et la question de la dette divise. T.Breton a du faire ses valises sur son initiative . Les critiques pleuvent. L'incurie est dénoncée, comme sa verticalité. L'affaire Pfizer n'est pas digérée. Le Pfizergate a laissé des traces. On lui reproche trop de naïvetés et un manque d'audace en ces temps incertains. Elle incarne les travers de l'eurocratie." Comment l’Europe doit-elle réagir aux futurs tarifs douaniers que Donald Trump annonce pour bientôt ? Comment doit-elle réagir à l’avancée technologique que représente DeepSeek, la nouvelle IA chinoise ? Comment doit-elle réagir aux menaces accrues qui pèsent sur sa sécurité et à la nécessité d’accroître ses dépenses de défense ? Comment l’Europe doit-elle réagir à ci et à ça ? L’UE n’est plus aujourd’hui qu’un assemblage politique qui cherche comment répondre le moins mal possible à ce qui se décide ailleurs.Sur les questions de défense, les leaders de l’UE, accompagnés du Royaume-Uni et du patron de l’Otan, se sont réunis en conclave le 3 février pour tenter de bâtir une réponse coordonnée. Pas facile pour l’Europe de la paix, l’un de ses piliers originels, de passer à l’Europe de la guerre. L’UE est en retard sur le plan technique, elle manque de financements et remédier à cela prendra beaucoup de temps. Le plus facile est d’acheter du matériel américain, au mieux acquérir des licences américaines et produire avec un seuil minimal d’inputs européens… Pas de quoi se réjouir et même de quoi inquiéter les industriels français de l’armement. ..." L'Europe traverse assurément une de ses crises les plus graves. Plus qu'une crise de confiance. -Le chemin sera long sur la voie d'un accord renégocié ou d'une refondation/ -Alors qu'en Italie, c'est arrière toute et qu'en périphérie, les replis nationaux, voire nationalistes gagnent du terrain. Le Brexit n'arrange rien -Si le rêve européen est à réinventer, c'est qu'il a été perdu, voire perverti; transformé en gestion économique néolibérale, en simple marché où la concurrence joue au dépends de la solidarité. -On attendait Erasme, disait quelqu'un, ce fut Moscovici qui vint. -Peut-on sauver ou changer le rêve européen et repenser une véritable souveraineté européenne?-Peut-on encore se contenter d' espoir ou d'envolées rhétoriques? allons-nousvers un hiver européen? -Jean Quatremer, pourtant fervent européiste, met parfois le doigt là où ça fait mal.
L'union européenne n'est pas une puissance politique. On l'a souvent répété.
C’est un édifice économico-juridique, où le droit a d’ailleurs été mis au service de l’économie, de manière à bâtir un grand marché dérégulé. L’UE s’est “néolibéralisée” au fil du temps de manière à devenir une petite mondialisation pure et parfaite dans un espace circonscrit. A l’intérieur, tout circule librement, les marchandises, les hommes, les capitaux. Conjointement à cela, tout ce qui vient de l’extérieur entre comme dans du beurre. En Europe, l’idée de frontière est diabolisée et associée au “repli national”. L’Union ne sait d’ailleurs pas vraiment où se situent ses frontières, puisqu’elle s’est construite sur l’idée potentielle d’un élargissement sans fin. Il y a quelques semaines à peine et malgré la multi-crise qu’elle traverse, le président de la Commission Jean-Claude Juncker proposait d’ouvrir des négociations d’adhésion avec la Macédoine et avec l’Albanie…
L’Europe actuelle est un espace liquide, une entité molle et post-polique, totalement inapte à agir dans les domaines régaliens. C’est l’aboutissement des choix qui ont été faits il y a longtemps, au tout début de l’aventure communautaire.
A l’origine en effet, deux conceptions opposées de l’Europe se sont affrontées en France (la France était alors la locomotive de Europe, presque toutes les initiatives venaient d’elle). La première était une vision intergouvernementale, portée par les gaullistes. Ces derniers souhaitaient bâtir une “Europe puissance”, c’est-à-dire une entité géostratégique indépendante dans grandes puissances de l’époque (les États-Unis et l’URSS), et capable de suivre sa propre voie. Dans les années 1960, il y eut les “plans Fouchet”. L’idée était de créer un “concert des nations européennes”, coopérant étroitement dans le domaine des Affaires étrangères, de la Défense et de l’éducation. Ces plans prévoyaient que les décisions soient prises par des Conseils des ministres dédiés à chaque domaine (Affaires étrangère, Défense et Éducation, donc), c’est à dire par des hommes politiques, des gens responsables devant leurs peuples, non par des techniciens. Par ailleurs, les décisions devaient être prises à l’unanimité, de manière à respecter scrupuleusement la souveraineté de chaque nation (ce qui est la condition nécessaire pour que vive la démocratie dans chaque pays : la souveraineté populaire suppose la souveraineté nationale). En pratique, cela aurait probablement nécessité beaucoup de géométrie variable, car tous les pays n’ont pas les mêmes besoins au même moment ni les mêmes tropismes. La Lituanie et la Grèce ne sont pas confrontées de la même façon à la question migratoire, par exemple. Des groupes de pays, dont la composition aurait sans doute été différente en fonction des sujets traités, auraient pu travailler ensemble sans qu’aucun d’eux ne soit contraint de participer à tout, contrairement à ce qui se passe dans l’Europe de l’uniformité psychorigide que nous connaissons.

Malheureusement, c’est la deuxième conception de l’Europe, celle des “Pères fondateurs”, celle, pour aller vite, de Jean Monnet, qui s’est imposée. C’est une Europe technique, marchande. Supranationale, aussi, puisqu’il s’agissait clairement, dans l’idée de ses concepteurs, d’effacer les nations (jugées guerrières) et d’ôter aux peuples (jugés tempétueux, irrationnels, trop passionnés) la charge de s’auto-gouverner. On a donc fabriqué un grand espace désincarné, a-démocratique, où seule l’économie semble exister, tout en échappant aux choix des peuples puisque la politique économique qui doit être menée (la même pour tous) est fixée une fois pour toute dans les traités. De plus, on a fait en sorte qu’il s’agisse d’un nain géostratégique, aligné sur la diplomatie américaine et défendu par l’OTAN. L’Allemagne – que son désir de s’ancrer définitivement à l’Ouest rendait amoureuse des États-Unis – a d’ailleurs une responsabilité particulière dans l’affaire. En effet, suite à l’échec des plans Fouchet au niveau de l’Europe des Six, de Gaulle s’est tourné vers le chancelier Adenauer et lui a proposé de faire affaire à deux. Ce fut le Traité de l’Élysée. Hélas, les parlementaires allemands ont voté au Bundestag un préambule unilatéral à ce traité, qui le vidait de sa substance. Dans ce préambule, il était acté que l’Allemagne privilégierait quoi qu’il arrive son engagement auprès de l’OTAN.Bref, si l’Europe se trouve totalement désarmée face à la question migratoire, c’est parce qu’il s’agit d’une question politique, pas d’une question technique. Et parce qu’elle relève du régalien, cependant que les Européens ont fait le choix de considérer qu’on était entré dans la post-histoire, et que ce type de sujets n’existait plus. La Commission essaie bien de trouver des solutions, mais ça ne fonctionne pas. Elle propose des quotas de migrants par pays, en bonne représentante de ce qu’Alain Supiot appelle « la gouvernance par les nombres ». Elle fait des règles de trois, élabore des indicateurs et dessine des diagrammes en bâton, mais elle ignore tout du réel et de ses contingences. Ce n’est, après tout, qu’une administration et, de surcroît, l’administration d’un non-Etat.
Je veux dire que l’Europe n’est pas un monde vierge et plane sur lequel il suffit d’appliquer des formules mathématiques. C’est un continent composé de pays très divers, avec des histoires, des traditions, des positions géographiques différentes.
Des trajectoires démographiques différentes également. Il y a, dans le Monde diplomatique du mois de juin, un dossier remarquable sur la question démographique en Europe. Sa lecture éclaire beaucoup de chose. On y découvre que dans ce domaine, les Vingt-huit ne sont pas logés à la même enseigne, loin de là. Un groupe de pays se trouve dans une situation particulièrement difficile, celui composé des pays d’Europe centrale et orientale (PECO). Entre une fécondité en berne, une mortalité qui a bondi après la chute de Mur de Berlin et, surtout, l’exode massif d’actifs qui partent chercher du travail à l’Ouest, les PECO se dépeuplent dans des proportions qui donnent le vertige. De quoi générer une angoisse existentielle profonde, une phobie de la « disparition ethnique » évidemment peu propice à l’accueil serein de populations étrangères.
Du coup, on comprend mieux le succès de ces droites conservatrices et anti-immigration à l’Est, du parti de Viktor Orban en Hongrie au PIS en Pologne, en passant par l’ANO de Andrej Babis en Tchéquie. Même la Slovénie, située sur l’ancienne “route des Balkans”, est désormais touchée. Et l’on se doute que ces pays ne céderont pas, qu’ils refuseront de se conformer aux quotas d’accueil de la Commission. De toute façon, il semble évident que les réfugiés ne souhaitent pas s’y installer non plus. L’an dernier, la BBC a consacré un reportage aux réfugiés arbitrairement “relocalisés” dans les pays Baltes. Confrontés à la difficulté de trouver un logement, un travail et au mauvais accueil qui leur est fait, beaucoup repartent dès qu’ils le peuvent. Évidemment.
Le Monde a trouvé la solution ! Dans un édito publié après la réunion des ministres de l’Intérieur des Vingt-Huit à Luxembourg (5 juin), on peut lire ceci : « Selon un rapport récent du think-tank européen European Stability Initiative, quatre pays, l’Allemagne, la France, l’Italie et la Grèce, ont concentré en 2017 près des trois quarts (72 %) des demandes d’asile (…). Ces quatre pays ont un intérêt prioritaire à réformer et à harmoniser le droit d’asile, et à négocier des accords de réadmission avec les pays d’origine, en particulier les pays africains dont les ressortissants ne peuvent pas prétendre à un statut de réfugié ». On y est : un groupe circonscrit de pays ayant intérêt à travailler ensemble sur un sujet particulier, pourraient s’atteler à une tâche commune, en mode “coopération intergouvernementale”. C’est d’ailleurs ce que dit Hubert Védrine dans une récente interview : « on peut prendre des initiatives nouvelles avec un nombre restreint de partenaires. S’il y a un domaine où les pays membres devraient agir de façon volontaire, coordonnée et rapide, c’est pour doter Schengen de vraies frontières (…) il faut que les ministres de la Justice, de l’Intérieur, des différents pays travaillent ensemble ». Les ministres, donc. Pas les technocraties “indépendantes” qui ne rendent de comptes à personne.
Reste un problème de taille : là où il faudrait une coopération étroite entre pays, le long processus d’intégration économico-juridique qui a prévalu jusque-là a créé de la divergence, de la méfiance voire de l’animosité. Le partage d’une monnaie unique par des pays dont les structures économiques n’ont strictement rien à voir, a généré une compétition féroce et une course à la déflation salariale dont le moins que l’on puisse dire est qu’il ne favorise pas l’amitié entre les peuples. Entre la Grèce et l’Italie d’un côté, l’Allemagne de l’autre, ce n’est pas l’amour fou. Le traitement quasi-injurieux réservé par la presse allemande à la question italienne il y a quelques jours en a à nouveau témoigné. L’Union européenne, le marché et la monnaie unique, sont en train de détruire toute forme de cohésion en Europe.
Je disais à l’instant que la manière dont on a construit l’Europe en a fait un simple marché, stratégiquement inféodé aux États-Unis et habitué à vivre sous leur aile. Les Américains eux-mêmes ont beaucoup fait, d’ailleurs, pour que le projet supranational de Monnet s’épanouisse et que l’idée d’Europe politique des gaullistes soit enterré : ils ne voulaient pas d’une Europe indépendante, et souhaitaient au contraire qu’elle soit leur pion. Pendant la Guerre froide, ils lui ont assigné le rôle de rempart contre le communisme. A la fin de celle-ci, ils ont considéré que l’UE élargie jouerait le rôle utile de “pôle d’attraction” pour un maximum de pays de l’Est, les détachant ainsi de l’orbite russe.
Mais depuis l’arrivée au pouvoir de Trump, les Européens ont parfois l’impression que les États-Unis les “lâchent”. C’est particulièrement vrai de l’Allemagne, qui est habituée, depuis la fin de la guerre (et même si les relations se sont beaucoup refroidies sous Schröder autour de la question irakienne) à ce que les Américains soient à ses côté. Ce sont eux qui ont initié la réforme monétaire de 1948 ayant abouti à la création Deutschemark, laquelle a précédé la fondation de la République fédérale d’Allemagne en 1949. C’est George Bush qui, après la chute du Mur de Berlin, a soutenu avec le plus de vigueur le projet de Kohl de réunifier le pays au pas de charge, cependant que les voisins européens de Bonn demeuraient sceptiques. C’est sur Washington que le pays d’Angela Merkel compte aujourd’hui pour sa sécurité, lui que son histoire particulière a conduit à opter pour le pacifisme et qui ne dispose pas des mêmes moyens de se défendre que la France ou la Grande-Bretagne. Aujourd’hui, la République fédérale ne cesse d’essuyer des reproches de la part de Donald Trump, que ce soit au sujet de ses excédents commerciaux jugés excessifs, ou de sa trop faible participation financière à l’OTAN. Elle se trouve prise au dépourvu et traverse une sorte de crise existentielle.
Et ce sont bien les excédents allemands que Trump a dans le viseur, lorsqu’il décide de prendre quelques mesures protectionniste vis à vis de l’Europe. Ces excédents sont dans le collimateur du Trésor américain depuis des années, et jugés propres à déstabiliser l’économie mondiale. Le fait est que ces excédents ont été obtenus parce que l’Allemagne mène une politique économique mercantiliste et de “tout-à-l’export”. Ceci la rend très dépendantes de ses clients, parmi lesquelles les États-Unis, et Trump le sait. Il mise sur la division des Européens et sur une probable volonté allemande de temporiser, afin que les prochaines marchandises taxées par Washington ne soient pas les berlines allemandes. A-t-il raison ou son attitude va-t-elle au contraire ressouder les Européens ? On en saura plus après le sommet du G7.
Dans votre dernier livre, avec David Cayla, vous pronostiquez la fin de l’UE. Cette perspective se rapproche-t-elle selon vous ? L’UE n’a-t-elle au contraire pas prouvé qu’elle pouvait survivre, même sans le soutien des citoyens ?... _________________________________