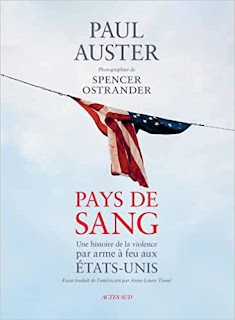Πόλεμος πάντων μὲν πατήρ ἐστι...
La guerre serait-elle le père de tout, comme l'écrivait le vieil Héraclite, en prenant le terme au sens large? Ou l'accoucheuse de nouvelles formes de société, comme le pensent certains du terrible conflit de 14-18, qui a amené un changement d'ère. Mais le philosophe grec pensait aussi aux luttes conflictuelles qui conditionnent la vie dans la nature: la lutte des espèces, comme les confit internes de notre vie organique entre les forces de vie et celles de dissolution, ente les virus et les globules blancs... Aucun cynisme ici, c'est une réalité vitale. Pour la guerre, c'est autre chose. Là s'affrontent passions et intérêts, parfois jusqu'à la démesure... Si on sait comment elle commence, on ne peut deviner comment elle finira... Qu'en est-il du conflit qui se déroule sous nos yeux, dont on voit pas l'issue, ni même la logique? Où est impliquée la Russie et sa prétendue partie rebelle, l'Ukraine. Les appréciations sont hésitantes, même si les partis pris sont fermes. Les incertitudes sont grandes sur la suite d'événements qui s'incrustent et se durcissent et ses conséquences, pas seulement européennes. Certains parlent de course au désastre, par analogie avec le conflit e 14-18, qui vit, par le jeu des alliances, un conflit s'éterniser dans des extrêmes non envisagés au départ. Difficile à savoir, à anticiper, dans les crispations actuelles et le feu de l'action. Dans l'aveuglement général, certains tentent des hypothèses, comme Stéphane Audoin-Rouzeau "... directeur d’études à l’École des hautes études en sciences sociales (EHESS), spécialiste de la Première Guerre mondiale et président du Centre international de recherche de l’Historial de la Grande Guerre. Il publie aux Belles Lettres La Part d’ombre. Le risque oublié de la guerre, en forme de dialogue avec Hervé Mazurel, historien des affects et des imaginaires. À partir de son travail sur la Première Guerre mondiale et sur l’anthropologie des violences de guerre, Stéphane Audoin-Rouzeau remet en cause la perception du conflit ukrainien. Pourquoi croire à une prochaine offensive russe ? Continuer à questionner les origines de la guerre revient-il à négliger de penser l’événement actuel ? Que serait une paix juste et à quel déni correspond le fait d’imaginer qu’un accord négocié en constitue l’inévitable issue ? Enfin : les pacifistes contemporains sont-ils des collabos ? Point de vue et entretien:

Mediapart : Andriy Yermak, bras droit de Volodymyr Zelensky, a récemment affirmé : « C’est la bataille de Verdun du XXIe siècle qui a lieu en ce moment à Bakhmout et à Soledar. » Au-delà de la communication ukrainienne, habile à renvoyer chaque pays à ses propres références, qu’est-ce que cela inspire à l’historien de la Grande Guerre que vous êtes ? _________Stéphane Audoin-Rouzeau : Je suis effectivement frappé par les ressemblances entre la Première Guerre mondiale et ce qui se déroule aujourd’hui en Ukraine. Après l’échec de la « guerre de mouvement » russe en février et mars 2022, le conflit s’est transformé en guerre de positions, sur un front très étendu, quoique beaucoup moins « compact » que durant la Grande Guerre. À l’époque, on trouvait près de trois millions d’hommes de chaque côté d’un front étendu sur 700 kilomètres. Aujourd’hui, il y a quelques centaines de milliers d’hommes de part et d’autre d’un front qui s’étire sur plus de 1 000 kilomètres. Mais, dans les zones très disputées, on voit se reconstituer des lignes de tranchées dont la morphologie est très similaire à celle des tranchées de la Grande Guerre, organisées selon un dispositif de lignes de défense successives. Ce système de siège réciproque, où chacun s’est enterré pour se protéger, est extrêmement difficile à briser, comme l’expérimentent les Russes à Bakhmout, mais aussi les Ukrainiens ailleurs : dans cette configuration, la défensive l’emporte sur l’offensive. C’est un type d’affrontement épuisant pour les combattants, puisque la bataille est continue et qu’il faut tenir les lignes jour et nuit. Un type de combat extraordinairement meurtrier également. Alors qu’on s’attendait à un scénario très différent, on se retrouve donc dans une situation proche de ce que l’on a connu il y a plus d’un siècle. On constate ainsi que l’arme de domination du champ de bataille est, de nouveau, l’artillerie, et non l’aviation, pour appuyer une infanterie dont le rôle reste déterminant. Du même coup, une notion qu’on pensait vieillie, celle de « forces morales », retrouve une nouvelle jeunesse pour rendre compte de la résistance militaire ukrainienne. ____Sans vouloir rejouer une querelle historiographique ancienne sur la part de consentement et de contrainte qui pèse sur les soldats du premier conflit mondial, diriez-vous que l’on voit aujourd’hui s’affronter en Ukraine une « armée du consentement » et une « armée de la contrainte », à en croire par exemple la vidéo récemment publiée par le « Guardian » montrant des soldats du groupe Wagner en train d’achever un de leurs officiers ? ____Tant qu’on ne disposera pas d’enquêtes approfondies de sciences sociales permettant de savoir comment la société ukrainienne et la société russe, ainsi que les forces armées des deux camps, ont réagi à la guerre lors des différentes phases de celle-ci, il me semble impossible de répondre de manière fiable à votre question. Sait-on ce qui se passe en profondeur dans la société russe ? Côté ukrainien, en tout cas, nous pouvons observer une société qui, dans son ensemble, consent à la guerre, en effet : ce qui signifie une acceptation du conflit et des sacrifices qu’il implique, une acceptation pleine de résolution qui vaut pour la partie armée de la population comme pour la population civile, en dépit des premières alertes lancées par Zelensky récemment, au sujet d’une forme de « relâchement » dans certaines villes. Ce consentement paraît reposer sur des bases assez semblables à celui des sociétés d’Europe occidentale en 1914 : un patriotisme défensif très fort et une hostilité marquée, voire une haine à l’égard de l’envahisseur. Il est rare d’être ainsi confronté à des formes de réitération de situations susceptibles de constituer en quelque sorte un « laboratoire » historique : or, la guerre en Ukraine suscite une sorte de boucle de rétro-interprétation de la Grande Guerre. Beaucoup ont eu du mal à admettre un « consentement » des soldats et des sociétés dans leur ensemble en 1914-1918 : précisément, l’évidence du consentement ukrainien depuis un an ne nous permet-il pas de mieux comprendre le consentement à la guerre des sociétés européennes au début du XXe siècle ? ____Vous rappelez dans votre dernier livre qu’« il faut un soubassement idéologique au déploiement des atrocités de guerre ». Quel serait-il, dans le cas de l’armée poutinienne qui commet ces atrocités de guerre ? L’argumentaire anti-Otan ou de « dénazification » peut-il vraiment faire office de soubassement idéologique suffisant ?

Tout d’abord, j’ai été frappé par le fait que, comme à l’été 14, les atrocités de guerre se soient manifestées immédiatement, dès la phase initiale de la guerre, au cours de laquelle la Russie pouvait encore espérer l’emporter rapidement. Elles ne sont donc pas liées à des phénomènes de résistance dans les zones occupées, ou à des formes de radicalisation ou d’épuisement des combattants russes après une longue phase de combats. C’est d’ailleurs la manière dont les contemporains de 14-18 se représentaient les choses. Très peu étaient capables de penser que la guerre allait durer des années, et moins encore de le dire. On attend donc la prochaine offensive comme les contemporains d’il y a un siècle l’attendaient eux aussi, dans un calendrier surdéterminé par les saisons. Alors, l’attente de l’offensive prochaine est-elle une forme de rumeur de guerre ? Observons que la logique de la guerre de positions pousse à ne pas rester éternellement enterré et à essayer d’ouvrir une brèche pour tenter d’en finir. ___Pendant la Grande Guerre, imaginait-on aussi des offensives « anniversaires » comme celle qui serait prévue autour du 24 février prochain ? Cette rumeur-là est étrange, car ce serait stratégiquement assez absurde, mais elle est peut-être intéressante à un deuxième degré. Dans toute guerre, je le disais, le problème du temps se pose à ceux qui la subissent : il faut essayer de le « rationaliser » pour rendre supportable son lent écoulement. On tente donc de baliser, chronologiquement, un calendrier dont les échéances restent, par nature, imprévisibles. Mais dans ce conflit, ce qui retient l’attention d’un historien, au-delà la guerre elle-même, c’est ce qu’il révèle « en creux » de notre relation à la guerre en général en Europe occidentale. Et notamment la façon dont nous avons collectivement oublié qu’elle demeurait un risque menaçant pour nos sociétés, au titre de mode de résolution des différends entre les États. Ce déni de guerre s’est manifesté constamment, notamment lors de l’avant-guerre, lorsque personne ou presque ne croyait à la possibilité d’une attaque russe. ___En annonçant un budget des armées de 413 milliards d’euros pour la période 2024-2030, en augmentation d’un tiers, Emmanuel Macron sort-il la société française du déni de la possibilité de la guerre ? Le réarmement européen actuel porte effectivement la marque d’une volonté de sortie de ce déni. Mais il faut distinguer les décisions des politiques et les réactions des sociétés. Jusqu’ici, la guerre en Ukraine ne « mord » pas sur la société française comme elle le fait en Pologne, dans les pays Baltes ou en Roumanie. Collectivement, je ne crois donc pas que nous soyons encore sortis du déni de la guerre – je veux dire : du déni de sa gravité, de la gravité de ses développements potentiels. Sent-on une inquiétude profonde à l’endroit de cette guerre ? Pensons-nous être directement concernés ? Pensons-nous que nous risquons de l’être ? Je ne crois pas…___Comment comprenez-vous la « surprise » qui a accompagné la révélation des crimes de Boutcha et d’autres villages ukrainiens, alors que vous rappelez dans votre dernier livre que la guerre, au moins depuis la Première Guerre mondiale, vise aussi, voire d’abord les civils ? Tout se passe comme si les conditions de possibilité de ces atrocités étaient tellement insupportables qu’il faut redécouvrir leur réalité à chaque nouveau conflit. Nous n’arrivons pas à considérer qu’elles sont toujours « dans les cartes », sans doute parce que cela reviendrait à admettre sur nos sociétés et sur nous-mêmes quelque chose à quoi nous nous refusons. Reconnaître pleinement que les atrocités de guerre sont un phénomène systémique - et selon moi central en temps de conflit - ne reviendrait-il pas à regarder en face ce qui se joue en profondeur en temps de guerre, du point de vue des acteurs sociaux ? C’est précisément ce qui est insupportable : paradoxalement, notre surprise et notre indignation nous protègent de cet aspect terrifiant du réel de la guerre… ____Vous revenez dans « La Part d’ombre » sur le concept de « brutalisation » des sociétés par la guerre, forgé par l’historien George Mosse. Est-ce qu’il désigne seulement la façon dont une société peut être brutalisée à long terme par la guerre, ou est-ce qu’il permet de penser les ressorts cachés de la violence dans une société ? Ce qui obsédait Mosse, c’était le lien, en Allemagne, entre la Première et la Seconde Guerre mondiale, et la façon dont la brutalisation des sociétés en 14-18 avait facilité la réitération de la guerre en 1939-1945, au prix de niveaux de violence plus élevés encore. Mais on peut regarder les choses autrement et s’intéresser aux ressorts cachés de la violence, plus puissants qu’on ne le croit généralement. Je pense que la vision de Norbert Elias selon laquelle nous formerions des sociétés à « haut niveau de pacification », comparées aux sociétés du passé, est fausse. Ce « haut niveau de pacification » n’est qu’une pellicule superficielle : dans une configuration qui l’autorise, le passage est aisé vers la violence. La plupart des conflits contemporains se sont réglés par la victoire militaire de l’un des belligérants sur l’autre et non par un accord de paix. À cet égard, ne peut-on pas suggérer que la société russe a été brutalisée depuis le début du XXe siècle ? Première Guerre mondiale, révolutions bolchéviques, guerre civile, collectivisation agraire et Grande Terreur stalinienne, Seconde Guerre mondiale, famine et durcissement du régime stalinien en sortie de guerre, effondrement final de l’URSS avec ses conséquences économiques, sociales, politiques et culturelles… Le concept de brutalisation, décidément, me paraît assez opérant pour rendre compte de certains phénomènes sociaux… ____Comment se fait-il qu’on parle presque moins aujourd’hui de la sortie de guerre qu’un mois après le déclenchement des hostilités ? On continue d’en parler, mais sur le mode : « à un moment ou à un autre, il faudra se mettre à la table des négociations et arriver à un accord de paix ». Mais qu’en sait-on ? La guerre de Corée ne s’est pas terminée par un accord de paix mais par un simple cessez-le-feu. Et la plupart des conflits contemporains se sont réglés par la victoire militaire de l’un des belligérants sur l’autre. L’idée que l’on va, à un moment, « revenir à la raison » et négocier me semble participer, une fois encore, d’une forme de déni. N’est-ce pas une manière – une de plus – de nous rassurer ? ___Qu’est-ce qu’une mauvaise paix ? Une paix qui humilie ou une paix qui permet à l’agresseur de reconstituer ses forces Je vous réponds par un détour. En 1951, alors qu’on ne sait pas si la guerre froide va devenir une guerre ouverte contre l’URSS, Raymond Aron, dans un essai intitulé Les Guerres en chaîne, écrit qu’« il importe cette fois d’abattre le monstre sans qu’il puise dans le sang versé et dans la défaite même des forces nouvelles ». S’il parle ici de l’URSS, Aron pense bien évidemment au précédent de l’Allemagne vaincue en 1918, dont le sang versé pendant la Grande Guerre avait fourni le terreau du nazisme, promoteur d’une guerre nouvelle infiniment plus meurtrière que la précédente. Entre 1989 et 1991, l’URSS s’est trouvée vaincue, mais sans une goutte de « sang versé » comme l’envisageait Aron quarante ans plus tôt. Pourtant, dans le ressentiment et le sentiment d’humiliation alors éprouvés, la Russie n’a-t-elle pas puisé, en effet, ces « forces nouvelles » dont il nous faut acquitter le prix, trente ans plus tard ? Une paix mauvaise me paraît donc le type de paix que redoutait Raymond Aron en 1951. Ce qui signifie sans doute qu’il n’y a pas d’autre issue que de gagner la guerre. Et de la gagner vraiment. Qu’entendez-vous par là ? C’est difficile à exprimer. Peut-on dire que nous avons malheureusement besoin d’une défaite russe décisive ? Et comment méconnaître alors les risques immenses que cela comporte pour nous tous ? Pour autant, peut-on espérer autre chose, au point où nous en sommes arrivés ? Si, à l’inverse, la Russie gagnait la guerre, nos démocraties occidentales, si fragilisées déjà, s’en remettraient-elles ? Nous aurions sur nos épaules la culpabilité de n’avoir pas suffisamment soutenu militairement l’Ukraine. Et nous aurions face à nous ces trois puissances qui constituent les soutiens directs de la Russie en guerre : la Chine, l’Iran, la Corée du Nord. C’est en ce sens que nous sommes face à une guerre idéologique, et même de plus en plus. La Russie a continûment durci son discours idéologique, tout en renforçant ses liens avec les pays déjà cités. Le camp démocratique de même, tout en resserrant ses rangs. Ce n’est pas parce que certaines guerres ont été fallacieusement menées au nom de la démocratie – et la Grande Guerre en fait partie dans une large mesure – que la guerre d’Ukraine ne met pas en jeu le sort de celle-ci. L’historien François Furet, à propos de la guerre de 14-18, disait que « plus un événement est lourd de conséquences, et moins il est possible de le penser à partir de ses causes ». On entend beaucoup de débats sur les causes de la guerre d’Ukraine, sur le rôle de l’Otan, etc. Tout cela a-t-il un grand intérêt, aujourd’hui ? Cette guerre longue, avec sa logique propre, a acquis une importance surdéterminante qui écrase la question des origines. Le propre des grands événements – et celui-ci en est un, assurément – est que ses enjeux dépassent la question des causes qui l’ont provoqué. Comment regardez-vous celles et ceux qui font aujourd’hui proclamation de pacifisme ? Le pacifisme de la Première Guerre mondiale, qu’il soit français, allemand ou britannique, n’a jamais été complaisant vis-à-vis de l’adversaire. En revanche, une partie des pacifistes français des années 1930 étaient pro-Allemands, c’est à dire pronazis. Le pacifisme éthique qui refuse par principe le déploiement de toute violence de guerre, comment ne pas le comprendre et le respecter ? Mais aujourd’hui, les pacifistes qui se refusent à armer l’Ukraine au nom de principes de paix travaillent en réalité, consciemment ou non, à une victoire russe. N’est-ce pas la nouvelle version d’un pacifisme de collabos ? (Joseph Confavreux)______________________________
StéphaneAudoin-Rouzeau est directeur d’études à l’École des hautes études en sciences sociales (EHESS), spécialiste de la Première Guerre mondiale et président du Centre international de recherche de l’Historial de la Grande Guerre. Il publie aux Belles Lettres La Part d’ombre. Le risque oublié de la guerre, en forme de dialogue avec Hervé Mazurel, historien des affects et des imaginaires. À partir de son travail sur la Première Guerre mondiale et sur l’anthropologie des violences de guerre, Stéphane Audoin-Rouzeau remet en cause la perception du conflit ukrainien. Pourquoi croire à une prochaine offensive russe ? Continuer à questionner les origines de la guerre revient-il à négliger de penser l’événement actuel ? Que serait une paix juste et à quel déni correspond le fait d’imaginer qu’un accord négocié en constitue l’inévitable issue ? Enfin : les pacifistes contemporains sont-ils des collabos ? Entretien.