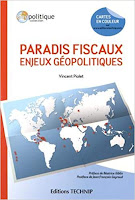La vache et le prisonnier.
L'hyper-capitalisme à l'étable. Un système devenu fou. ____Le productivisme sans frein, dans certains secteurs agricoles, notamment dans la production laitière, en Bretagne plus qu'ailleurs, débouche sur des situations où, au nom de la "libre" concurrence, les prix bas imposés par les géants de la transformation laitière, la vie des éleveurs, pris dans une logique hautement productiviste, devient une course en avant perpétuelle à la production effrénée, à la modernisation à tous prix, à l'endettement permanent, à la solitude et même souvent au désespoir. ____ On s'interroge sur le nombre de suicides élevés dans le monde agricole. Une des raisons principales est l'absurdité de ce qui se passe en silence au coeur de nos systèmes de production fermiers, devenus trop souvent des usines où le beau mot d'éleveur a perdu son sens...Souvent pointée du doigt, la souffrance au travail n'est pas seulement sur les chaînes de montage industriel. Les super-grands de l'industrie laitière et leur logique propre, surtout quand la PAC a disparu, font la pluie et le beau temps dans nos étables, jusque dans les détails. On connaît les méthodes de Lactalis en particulier, qui a défrayé plus d'une fois la chronique. ___C'est le cercle vicieux de la course au gigantisme. Quelques centimes de plus par litre de lait et la tendance pourrait s'inverser. Pour l'instant, beaucoup d'éleveurs sont prisonniers...parfois désespérés, comme le montre le film ''Petit paysan"....Une logique infernale. Le capitalisme de papa est entré dans les fermes, où plutôt l'exploitation tend à devenir la règle dans nos exploitations. A bas bruit. Mais on fait mieux ailleurs! ...Et si les vaches mangeaient de l'herbe?...

.".....Dans un gigantesque bâtiment de cinq mille mètres carrés, des centaines de vaches qui ne fouleront jamais l’herbe déambulent sous de grands ventilateurs-brumisateurs qui tournent silencieusement. À intervalles réguliers, de petits wagonnets parcourent le corps de ferme sur leurs rails, circulant d’un silo de stockage à l’autre, mélangeant les aliments et distribuant les rations. Dans l’étable, rebaptisée « stabulation », les vaches vont et viennent autour de quatre imposantes machines rouges. Ce sont des robots de traite. Attirées par une ration de granulés, elles viennent s’y placer à tout moment du jour et de la nuit, laissant les portes se refermer le long de leurs flancs. Le processus est entièrement automatisé : le robot commence par identifier la vache grâce à son collier électronique, puis il détecte l’emplacement de ses pis au moyen d’une caméra intégrée. Débarrassés de leurs saletés par un rouleau nettoyeur, ceux-ci sont ensuite scannés par un laser 3D rouge qui détermine la localisation des mamelles au millimètre près. La machine y place alors ses gobelets trayeurs : la traite peut commencer... En ce mois de septembre 2020, une journée portes ouvertes est organisée à l’exploitation agricole des Moulins de Kerollet, à Arzal, dans le Morbihan. M. Erwan Garrec, éleveur laitier d’une quarantaine d’années, a fait une heure de route pour assister à cette démonstration du dernier robot de traite de la marque Lely, qui domine le marché. Investir dans un tel système, « c’est s’offrir les services d’un “employé modèle”, capable de traire vos vaches vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sept jours sur sept, pendant de nombreuses années », vante la brochure du groupe. « Ça vous dégage du temps et vous libère des contraintes liées à la traite », commente un vendeur du stand, avant de préciser : « À la moindre anomalie ou panne, vous recevez une alerte sur votre smartphone. » Grâce à son système de traite en continu, ce robot « permet d’augmenter facilement votre production de 10 à 15 % ».... M. Garrec n’a pas de smartphone, mais il rêve de la liberté qu’offrirait pareille technologie, lui qui s’occupe seul d’une grosse centaine de vaches laitières et travaille sans relâche plus de quinze heures par jour, trois cent soixante-cinq jours par an. Mais la liberté a un prix : s’offrir les services d’un de ces « employés modèles » impliquerait de débourser 150 000 euros, sans compter les 12 000 euros annuels de maintenance et les travaux d’aménagement à effectuer dans le bâtiment. Il faudrait de plus en changer tous les dix ans. Et, comme l’automate sature à partir d’une soixantaine de vaches, son exploitation en exigerait deux. Le vendeur le rassure : « Pour l’emprunt, on peut s’arranger. Le Crédit agricole encourage ses clients à se moderniser. Nous, on les connaît bien. » Des emprunts, M. Garrec en a déjà contracté plusieurs. Pour son bâtiment, d’abord. Comme il a dû doubler le nombre de ses vaches afin de garantir la survie de son exploitation, il a fallu agrandir la ferme familiale, qui ne suffisait plus : une salle de traite plus vaste, un second silo pour stocker davantage de maïs. Et, comme il fallait plus de maïs, il a fallu doubler le nombre d’hectares destinés à en produire, et donc acquérir de nouveaux tracteurs..... M. Garrec produit aujourd’hui un million de litres de lait par an, soit trois fois plus que la moyenne des éleveurs laitiers français. Une telle performance implique une course quotidienne contre la montre. Chaque matin, M. Garrec franchit en courant la centaine de mètres de pâturages qui séparent sa maison — construite sur l’une des parcelles de son exploitation — du bâtiment où se trouvent les vaches. Vêtu d’un bleu de travail, un seau à la main, il court encore, cette fois d’un bout à l’autre de sa stabulation de deux mille mètres carrés où flotte l’odeur nauséabonde du maïs ensilage (1). Ses gestes sont répétitifs et ajustés au centimètre près, pour économiser de précieuses secondes. Ce matin, il jette un coup d’œil rapide à sa montre et lance : « Ça va, on est dans les clous !.... « Grâce à cette alimentation, les vaches sont plus performantes », nous explique-t-il. Et puis, les faire pâturer s’avérerait chronophage, car elles sont nombreuses. Mais ce régime alimentaire coûte cher. Le maïs, qui vient de ses champs alentour, constitue son « plus gros poste de dépenses » : il nécessite des semences, des intrants, de l’irrigation et du travail agricole — externalisé par manque de temps. Le maïs ensilage étant dépourvu de protéines, les rations distribuées aux vaches s’accompagnent de granulés de soja génétiquement modifié venu d’Amérique latine, ainsi que de minéraux et d’oligo-éléments en poudre.... Les vaches de M. Garrec sont des prim’Holstein, une race réputée pour être la plus productive du monde. « Le problème, c’est qu’elles sont fragiles. Il y a donc des frais de vétérinaire importants. » L’éleveur a cependant pu améliorer la productivité de son cheptel en recourant aux services de la coopérative d’insémination et de génétique animale Évolution. Son catalogue de plus d’une centaine de taureaux permet d’améliorer les performances des vaches, en adaptant par exemple leur morphologie (taille et hauteur de la mamelle, notamment) aux caractéristiques de la trayeuse. Cela n’empêche pas que 30 % du troupeau parte à l’abattoir chaque année en raison de mamelles non standards et de pis inadaptés. La proportion monterait à 50 % avec le calibrage du robot Lely Astronaut. « On a un travail répétitif comme celui d’un ouvrier. Mais nous, on est notre propre patron. On prend des risques, on investit, on fait vivre et travailler plein de gens », développe M. Garrec en branchant inlassablement ses vaches aux trayeuses.... À vrai dire, c’est d’abord Lactalis, numéro un mondial des produits laitiers et treizième groupe agroalimentaire de la planète, que notre agriculteur fait vivre. « Là, je suis en train de produire le lait du mois de septembre, mais je ne sais pas encore à quel prix je le vendrai. » Car, dans la filière, c’est le client (ici Lactalis, mais il en va de même avec ses concurrents) qui fixe le prix et qui facture le produit, envoyant tous les mois au producteur sa « paye de lait ». Le contrat qui lie les deux parties ne fixe pas le prix, mais le nombre de litres qui doivent être produits. Il est 1 heure du matin lorsque la course folle de M. Garrec prend fin. Après la traite du soir, il éteint la lumière du bâtiment et parcourt les pâturages en sens inverse, dans la nuit noire, guidé par la lumière de son téléphone, deux bouteilles de lait encore chaud à la main. Fourbu, il avale, avant de se coucher, un Nesquik dans lequel il a jeté de la semoule : « Ça prend cinq minutes. » Dans quelques heures, tout recommence..... Selon M. Ronan Mahé, lui aussi éleveur, cette fragilité trouve également son principe dans le fait que, « depuis trente ans, le prix du lait n’a pas changé, et a même baissé ; pendant ce temps-là, tout a augmenté : aliments, matériel, charges, cotisations, mises aux normes, etc. ». Plus du quart des paysans vivent ainsi sous le seuil de pauvreté, avec des revenus souvent inférieurs au revenu de solidarité active (RSA). Ils sont la catégorie socioprofessionnelle la plus touchée par la misère. En 2017, près de 20 % d’entre eux ont déclaré un revenu nul, voire un déficit de leur exploitation.... Lactalis avait atteint 20 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2019, « avec un an d’avance sur ses objectifs ». Au cours de cette année « historique », le groupe a connu sa plus forte croissance, avec notamment neuf acquisitions. La fortune de M. Besnier a suivi la même progression, le hissant à la neuvième place du classement Challenges des personnes les plus riches de France (il est depuis redescendu à la onzième place). Lors d’une conférence de presse, il a également annoncé que le prix du lait allait encore baisser, « pour affronter les difficultés qui s’annoncent dans le secteur laitier » en raison de la pandémie de Covid-19 (3). « Il y a une course à la baisse entre les industriels, explique M. Le Bihan. Ils tirent les prix vers le bas pour dégager de la marge et rester concurrentiels. Lactalis, Sodiaal [première coopérative (4) laitière française] et les autres tiennent tous le même discours. ».... À la mi-septembre 2020, au moment même où M. Besnier savourait la réussite de Lactalis, « exemple presque parfait des succès du capitalisme familial à la française », lors de « son anniversaire, avec sa femme et ses trois enfants, en vacances à l’île de Ré (5) », M. Garrec nous confiait, assis à la table de son salon aux murs nus, face à la fenêtre par laquelle il voit passer ses vaches, qu’il rêvait de « fonder une famille ». Avant d’ajouter avec un soupçon d’angoisse dans la voix que, célibataire à 43 ans, il avait intérêt à ne plus traîner. Mais encore faudrait-il qu’il puisse « consacrer du temps » à sa famille, ce qui signifierait « soit prendre un employé, soit prendre un robot » — comme le Lely Astronaut dont il observait attentivement la démonstration quelques jours plus tôt. Or, dans les deux cas, cela impliquerait « de produire plus, pour compenser le coût ». Et donc de poursuivre sa course infernale contre le temps." ( Maëlle Mariette) ____________________